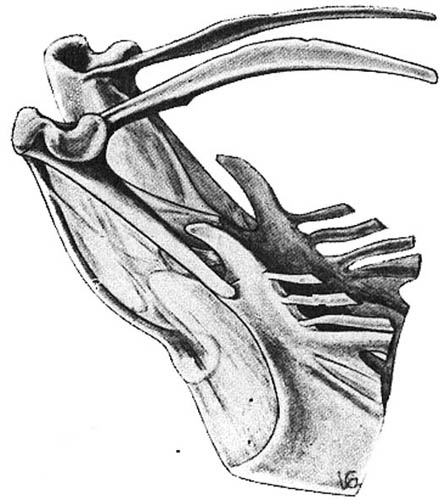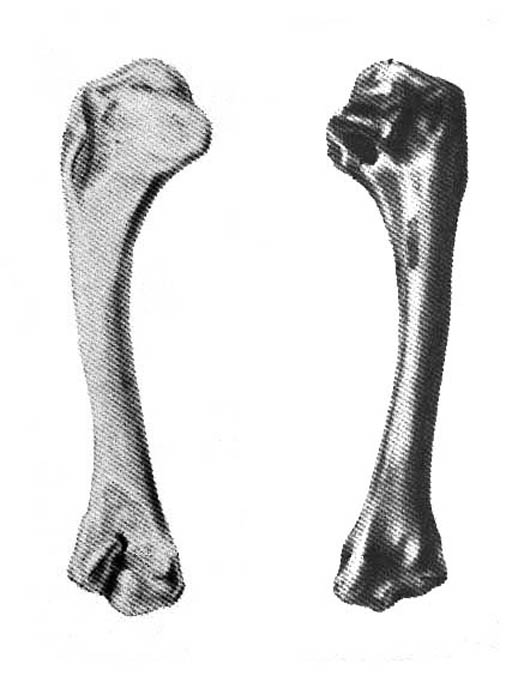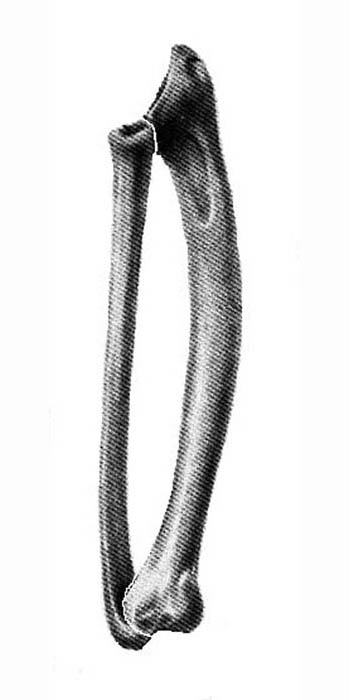Scapula
C’est un os long et aplati, pneumatisé,
en forme de sabre. La scapula repose parallèlement
à la colonne vertébrale contre la paroi thoracique.
Elle démarre au niveau de la dernière vertèbre cervicale
et atteint le bord crânio-latéral de l’ilium caudalement.
Sa région proximale est bien visible
sur les 2 projections radiographiques de la cavité cœlomique,
sa portion distale est parfois plus difficile à
distinguer. La partie proximale de la scapula présente latéralement
une concavité qui participe à la constitution de
la cavité glénoïde dans laquelle vient se loger la tête
humérale. L’acromion ou processus claviculaire,
médial, forme une syndesmose avec la clavicule, tandis que le processus
coracoïdien, protubérance convexe, s’articule avec le
coracoïde
Coracoïde
C’est le plus robuste des os de la ceinture de l’épaule.
C’est un os creux, envahi par le sac aérien claviculaire.
Sa partie distale s’articule avec le sternum. Il a une direction oblique
crânio-dorsalement. Sa partie proximale porte une large surface
concave orientée caudalement qui participe à la formation
de la cavité articulaire de l’épaule. De l’autre
côté de la surface articulaire, la tubérosité
furculaire constitue le point d’ancrage du tissu conjonctif
qui unit le coracoïde à la surface médiale de la clavicule.
Il est bien visible sur les 2 vues de la cavité cœlomique.
Sa fonction est celle d’un étai qui bloque l’aile à
une certaine distance du sternum.
Clavicule
Elle est très développée chez les oiseaux et a la forme
d’une baguette. Les 2 clavicules sont soudées
et constituent un os unique appelé fourchette ou os furculaire
(ou os à souhait). Les 2 branches s’appuient sur
les 2 pointes scapulo-coracoïdiennes (syndesmose entre
la tubérosité furculaire du coracoïde et le processus caudal
porté par l’extrémité proximale de la branche claviculaire,
ligament unissant la pointe de la clavicule à l’acromion de la
scapula). Leur extrémité distale, le processus furculaire,
est reliée à l’apex de la carène
du sternum par un ligament. La fourchette joue le rôle d’un ressort
qui maintient l’écartement des épaules lors des mouvements
de l’aile. Elle est bien identifiable sur la vue latérale de la
cavité cœlomique. Nous l’observons crânialement sur
la vue ventro-dorsale.
Ces 3 os délimitent une ouverture située dorsalement
appelée foramen tri-osseux, par où passe le
tendon du muscle supra-coracoïdien avant d’aller s’insérer
sur la tubérosité latérale de l’humérus
(ce muscle est un des moteurs principaux du mécanisme du vol : il est
élévateur de l’humérus et de l’aile).
L’aile
se caractérise chez tous les oiseaux par une spécialisation
remarquable des régions carpienne et métacarpienne
qui se traduit par une réduction considérable du nombre
d’os.
La structure du squelette de l’aile et la taille respective
des différents segments varient selon les aptitudes de vol
de l’oiseau :
- chez les martinets et les colibris qui pratiquent le vol battu, l’humérus
est très court ; en revanche les os de la main ont un développement
remarquable car la main est l’élément propulseur pendant
le vol,
- à l’inverse, les planeurs comme les marabouts et les pélicans
ont le bras, l’avant-bras et la main de longueur sensiblement égale
et cela accroît les dimensions du plan sustentateur nécessaire
pour le vol plané.
C’est
un os relativement court et fort, légèrement
incurvé, tubulaire, largement pneumatisé
par le diverticule latéral du sac aérien claviculaire.
La tête de l’humérus a une forme
ovoïde. Le tubercule latéral se situe
dorso-latéralement à la tête. Il se poursuit par un pont
osseux incurvé latéralement, la crête du tubercule
latéral. Le tubercule médial démarre
ventro-médialement. Il est séparé de la tête de
l’humérus par un profond sillon ; il se prolonge distalement
par une crête proéminente, la crête du tubercule
médial.
Chez certains rapaces diurnes (accipitridés) et nocturnes (quasiment
tous les hiboux, absent chez la chouette effraie), il existe à la surface
profonde du muscle deltoïde majeur, dorsalement à l’articulation
de l’épaule, un petit os appelé os huméro-scapulaire.
Cet os est visible sur les radiographies, il ne faut pas le confondre avec
un fragment osseux provenant d’une fracture .
Tandis que la tête est orientée crânio-médialement,
la trochlée humérale, surface articulaire distale
de l’humérus, pointe caudo-latéralement. Le condyle
ulnaire hémisphérique se projette un peu plus distalement,
et le condyle radial cylindrique est tourné latéralement.
De chaque côté de la trochlée sont situés les épicondyles
(l’épicondyle ulnaire très volumineux, et le radial plus
petit).
La
ceinture pectorale se compose de 3 paires d’os qui supportent
les ailes.
Ces os sont souvent mieux visualisés sur les vues de la cavité
cœlomique que sur celles des ailes.
L’ulna
est le plus volumineux des 2 os de l’avant-bras. C’est
un os légèrement incurvé. Le radius
plus rectiligne est dorsal et crânial par rapport à l’ulna.
Ils ont à peu près la même longueur,
sont parallèles l’un à l’autre
et s’articulent ensemble proximalement et distalement.
L’olécrane n’est que faiblement développé.
Le corps cylindrique de l’ulna porte une série de petites
projections osseuses qui représentent les points d’ancrage
des rémiges secondaires.
La partie proximale épaissie de l’ulna porte le cotyle
huméral ulnaire, cavité articulaire qui reçoit
le condyle huméral ulnaire. Latéralement à cette cavité,
se trouve une large dépression entourée par
une protrusion osseuse aux arêtes étroites. La facette
articulaire latérale du radius vient s’y loger. Le condyle
distal de l’ulna est au contact du radius, des os carpiens
ulnaire et radial.
La tête du radius porte le cotyle huméral radial.
Il s’articule avec le plus petit des condyles huméraux. La terminaison
distale du radius porte un condyle qui s’articule à
l’os radial du carpe.
Carpe
Il n’y a que 2 os carpiens : ils proviennent de la
fusion des os de la première rangée du carpe qui se produit
pendant le développement embryonnaire.
L’os radial du carpe s’articule au radius et
à l’ulna. L’os ulnaire du carpe ne s’articule
qu’à l’ulna. Tous 2 s’articulent au carpométacarpe.
Chez certains rapaces il existe un os supplémentaire en région
carpienne. Cet os se situe crânialement au bord proximal
du carpe. Il est articulé avec la partie distale du radius
et relié au radius, à l’os radial du carpe et au carpométacarpe
par des ligaments. Il a une forme grossièrement triangulaire
chez les rapaces diurnes. Sa base est orientée parallèlement
au radius, son apex perpendiculairement. Il est relativement petit,
elliptique, présentant un grand axe orienté parallèlement
au radius chez les rapaces nocturnes. Il s’interpose sur le
trajet du muscle long tenseur du patagium et intervient lors de l’action
de ce muscle à son point d’insertion sur la partie la plus distale
de la main (doigt alulaire proximal). On visualise cet os supplémentaire
du carpe sur la vue ventro-dorsale de l’aile et sur la vue crânio-caudale
si le membre est en légère rotation (de façon à
ce que le radius et l’ulna ne soient pas entièrement superposés).
L’intégrité de cet os est à prendre en considération
lors de l’évaluation de l’atteinte de l’aile et pour
l’établissement d’un pronostic de guérison totale
ou d’amélioration c’est à dire de l’estimation
des chances de survie d’un rapace blessé recouvrant sa liberté.
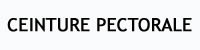
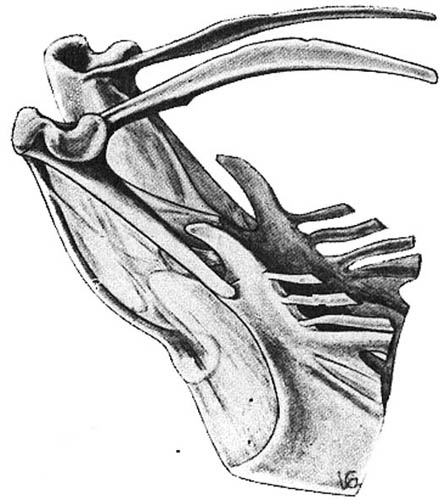

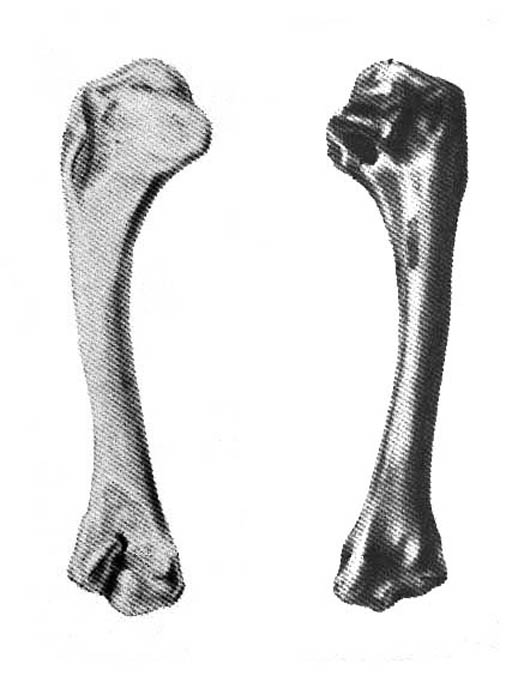

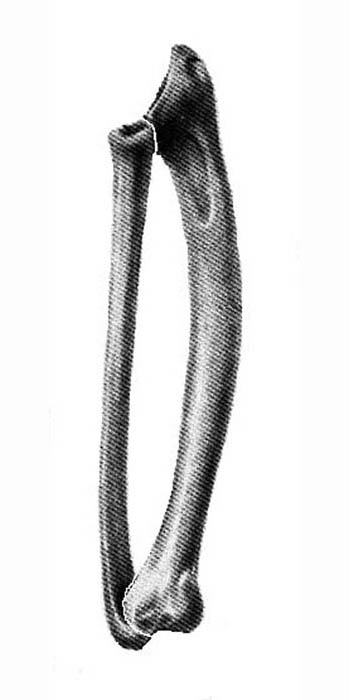


Les doigts
Ils sont au nombre
de 3 :
- doigt I (doigt alulaire) : une seule phalange en forme
d’épine chez le pigeon, il en existe une 2ème toute petite
et pointue chez les volailles, le canard et l’oie,
- doigt II (doigt majeur) : c’est le plus développé,
il comporte 2 phalanges ; la 1ère peut-être comparée à
une lame de couteau avec un bord épais et une arête étroite,
la 2ème a la forme d’un cône pointu et se prolonge chez
l’oie par un petit os en forme d’épine qui correspond au
vestige de la 3ème phalange,
- doigt III (doigt mineur) : il ne se compose que d’une
phalange.